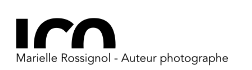CRONICAS DE RUEDO
OUVERTURES ET AVENTURES
Parmi les clichés des amateurs de culture tauromachique, la référence à Ernest Hemingway n’est ni la moins utilisée, ni la moins utile. On sait peu, en revanche, l’importance de la photo dans son parcours d’amateur. La rencontre entre le boxeur journaliste et les arènes de Pampelune ne fut pas fortuite. Elle est le bout d’un fil tiré à partir de photos étudiées depuis son bureau chicagoan. Des images l’amenèrent à traverser l’Atlantique pour y satisfaire sa curiosité et y découvrir une passion. Des images le conduisirent à partir en voyage à la découverte d’une culture exotique.
Exotique. Tel était sans doute le regard premier que cet homme porta sur ces pratiques étranges et étrangères. De cet exotisme et de son histoire personnelle naquirent la tolérance qui lui permit de les voir. De voir le grand spectacle de la vie et de la mort par delà la morbidité du combat. De voir le culte de l’animal par delà les souffrances infligées. De voir la métaphore d’une lutte de l’Homme contre lui-même, d’aimer la violence rituelle, la mise en scène religieuse du combat, comme s’il était plus facile de tolérer les déviances de cultures lointaines au nom de leur différence. Survivant blessé de la première guerre mondiale, Hemingway portait pourtant sur la violence du monde un regard sans concession, le regard d’un boxeur peu impressionnable et peu impressionné par la vue du sang.
En 1920, le monde était différent quoique les hommes furent semblables. Notre rapport à la nature était déjà celui que nous connaissons mais sa nécessaire transformation ne nous était pas encore venue à l’esprit. Nous étions trop occupés à faire grandir l’aventure humaniste sur le sol infertile des nationalismes et des écarts de richesse. Nous étions déjà davantage Gastby que Rabhi.
Aujourd’hui, nous vivons un moment paradoxal, hypocrite diront certains, du monde occidental. Des citadins encitadinés fantasment l’imaginaire retour à la terre pendant que d’autres citadins encitadinés inventent un culte du vivant désincarné dont la mort et la violence sont fantasmées ou absentes. Nous tâtonnons, nous trébuchons dans notre quête de respect du vivant, et nous commettons les mêmes erreurs qui furent celles de la conquête de l’humanisme. Nous sommes de plus en plus aveugles à l’inhumanité du règne animal, nous devenons condescendants et naïfs plutôt que véritablement respectueux. Comme nous nous refusons à rendre à l’animal sa place sur la Terre, à le considérer vraiment, nous lui en attribuons une nouvelle, soigneusement dessinée et conceptualisée par nous, les humains. L’animal est alors perçu, au mieux, comme un bon sauvage, au pire, comme un gentil domestique, dans la plus pure tradition de ce que fut l’exotisme sur la route de l’égalité entre les femmes et les hommes de cette planète. On en vient même à douter qu’il puisse être honorable d’en manger, piétinant les traditions paysannes, la ruralité originelle, nous coupant définitivement d’un type de rapport à la nature, qui fit de nous ce que nous sommes, des survivants devenus conquérants par la force de la pensée, et que l’industrialisation a ravagé mieux qu’un nuage de criquets. Au carrefour de la culture et de l’élevage. C’est à cet endroit-là que se situe l’art tauromachique. C’est cette histoire-là qu’il raconte. Et c’est bien parce que l’animal y est brièvement considéré́ comme un alter ego, digne de la lutte, digne de mourir sur scène, qu’il est, du point de vue des aficionados, respecté.
Je ne suis pas certain que la probable disparition de cette représentation théâtrale dans le grand bain mondialisé raconte un plus grand respect du règne animal. Je pense qu’il raconte surtout notre éloignement de la chair par un esprit de méthodes qui divise en catégories distinctes les continuum de couleurs, les nuances. Nous devenons virtuels, nous nous désincarnons et nous souhaiterions pouvoir désincarner le monde autour de nous. Notre culture n’est plus capable de parler de la mort d’un animal ou de s’y confronter sans artifice. Nous voyons des hectolitres de sang sur des écrans virtuels mais sans plus pouvoir en toucher sans un sentiment de dégoût. Alors, au-delà des nécessaires évolutions que la culture tauromachique doit s’imposer à elle-même pour survivre au siècle, sortir de son essence machiste, mieux mettre en scène sa relation entre l’homme et l’animal, élever son culte de l’élevage, et peut-être transformer la souffrance physique en symbolique, la photo peut nous inviter à la regarder et à la considérer avec le respect que nous devons à toute culture autochtone. Une aventure.